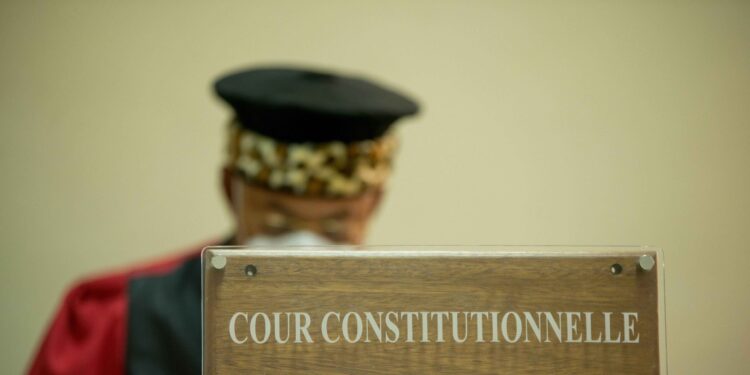Analyse critique de l’arrêt RP 0001 de la Cour constitutionnelle congolaise du 15 novembre 2021 MP c° Matata Ponyo, Kitebi Kibol, Grobler Christo
Par
Pius DJOLI A MBONDA
Doctorant en Droit public
L’objet de notre observation relative à l’arrêt RP 0001 de l’affaire Matata est de discuter la méthode adoptée par un juge particulier dans son raisonnement juridique. Ce juge est la Cour constitutionnelle, dans sa casquette de juge pénal.
Par un arrêt en date du 15 novembre 2021, la Cour constitutionnelle s’est prononcée sur les poursuites pénales initiées devant sa juridiction par le Procureur général près la Cour constitutionnelle à l’encontre principalement de Monsieur Matata Ponyo Augustin, et ses présumés complices Kitebi Kitobi Patrice et Grobler Christo, pour des infractions commises entre novembre 2013 et novembre 2016 à l’occasion de l’exercice de ses fonctions de Premier ministre. Cette affaire a suscité des commentaires abondants, des prises de position politiciennes, mais l’avantage avec la doctrine juridique est que « elle permet de prendre de la hauteur, de la distance, de penser le droit plus calmement et plus profondément sans la passion des causes du moment, sans intervenir en défense d’un cas concret »[1].
En l’espèce, Monsieur Matata Ponyo, Premier ministre de mai 2012 à novembre 2016, est accusé, avec ses deux présumés complices Kitebi KIbol et Grobler Christo, respectivement ministre délégué auprès du premier ministre en charge des finances du gouvernement, et dirigeant de la société Africom Commodities, d’avoir détourné la somme de 204.903.042 USD qui était remise à la Société Africom Commodities pour la gestion du Parc Agro-Industriel Bukanga Lonzo, projet mis en place par le Gouvernement de la RDC. Dans les mêmes circonstances de lieu et de temps que dessus, comme co-auteurs, par coopération directe, ils sont également accusés d’avoir détourné la somme équivalente de 890.702.80 USD en payant indûment les parts sociales de la Société Africom commodities dans la constitution des sociétés d’économie mixte Parcagri, Sepagri et Marikin, sociétés issues de la convention d’actionnaires entre l’État congolais et la société Africom commodities, alors que cette dernière devait elle-même apporter ses parts sociales. Il leur est en outre reproché d’avoir détourné la somme équivalente de 122.652,83 USD et celle équivalente à 3.798.000 USD destinées respectivement au bornage de la concession du Parc Agro-Industriel de Bukanga Lonzo et à l’aménagement de la route qui relie ce parc à la nationale n°1. C’est ainsi que, pour ces faits prévus et punis par les articles 21 et 23 du Code Pénal Livre 1er, 145 du Code Pénal Livre II, le Procureur général près la Cour constitutionnelle sollicita, par une requête du 27 août 2021 au président de la Cour constitutionnelle, la fixation de la date d’audience pour les poursuites judiciaires.
La Cour a déclaré son incompétence à poursuivre le prévenu Matata sur base de l’article 163 de la Constitution, sans qu’il soit nécessaire, selon elle, d’examiner tous les moyens invoqués par les prévenus.
Dès lors, le problème juridique dans cette affaire est le suivant : la Cour constitutionnelle est-elle compétente pour poursuivre pénalement un individu pour des infractions commises au moment où il était Premier ministre (dans l’exercice de ses fonctions de Premier ministre) ?
Si la Cour se borne à une interprétation restrictive de sa compétence pénale (I), celle-ci s’avère néanmoins contraire à la volonté du constituant, elle soutient que le privilège de juridiction prend fin à la cessation des fonctions de Premier ministre (II). Un regard sur le cas des anciens Premiers ministres et ministres français dont les dispositions constitutionnelles relatives à la responsabilité des membres du gouvernement s’apparentent, dans une certaine mesure, à celles du premier ministre et de l’ancien premier ministre congolais, s’avère utile. Il nous parait également judicieux, pour l’intérêt de la science, d’analyser le moyen développé par les conseils de M. Matata concernant la subordination de la compétence de la Cour à la possibilité de la déchéance du Premier ministre (III).
I. L’interprétation restrictive de sa compétence pénale
Dans l’arrêt RP 001 du 15 novembre 2021, la Cour constitutionnelle rappelle que «il n’y a pas de juge ou de juridiction sans la loi, ce qui veut dire qu’une personne ne peut être poursuivie que devant une juridiction préalablement connue dans un texte de loi. Il s’agit là d’un principe constitutionnellement garanti par l’article 17 alinéa 2 de la Constitution ».
Elle statue ainsi que « Matata Ponyo Augustin, qui a cessé d’être Premier ministre en fonction au moment où les poursuites contre lui sont engagées, ne saurait être poursuivi devant elle sur base de l’article 163 de la Constitution ». La Cour constitutionnelle se fonde donc sur une interprétation littérale et étroite de l’article 163 de la Constitution qu’elle postule comme la seule possible. Elle estime que le constituant de 2006 a en effet limité la compétence pénale personnelle de la Cour constitutionnelle au Président de la République en fonction, au Premier ministre en fonction ainsi que leurs coauteurs et complices. L’approche littérale est certes importante pour saisir le sens de la règle juridique, mais elle ne suffit pas entièrement pour déterminer la règle juridique à appliquer dans une situation donnée. On peut d’ailleurs se demander comment la Cour peut-elle justifier son interprétation restrictive de sa compétence par le motif qu’elle doit obéir à la loi, alors que, dans plusieurs de ses arrêts[2], elle a souvent fait oeuvre de constituant secondaire[3]. La réponse se trouve sans doute dans le fait qu’en l’espèce, on est en matière pénale, et comme elle le dit elle-même dans le 15e feuillet de l’arrêt, « la théorie de l’interprétation du droit pénal est marquée par le caractère strict de l’interprétation ».
Cependant, une telle restriction n’est pas sans poser de sérieux problèmes. En effet, dans le cadre de l’affaire sous examen, la Cour constitutionnelle a reconnu que « sa compétence pénale procède de la Constitution ». Cela dit, des arguments d’interprétation stricte valent sans doute pour appréhender le droit positif pénal et des méthodes d’interprétation des lois pénales, mais ne s’imposent pas en présence des dispositions constitutionnelles souvent larges et peu précises. Une Constitution c’est plus l’esprit que la lettre. Son interprétation ne repose pas uniquement sur une exégèse grammaticale, mais peut se baser sur d’autres considérations, notamment historiques, ou fonctionnelles. Ainsi, pour notre part, nous privilégions le recours à l’interprétation systémique[4], consistant à prendre en considération le texte constitutionnel dans sa globalité[5]. Cette approche systémique de l’interprétation invite à observer que la compétence pénale de la Cour constitutionnelle se détermine à la lumière aussi bien des articles 163 et suivant de la Constitution, que de l’article 99 alinéa 5 de la Constitution. Cette disposition, doublée de l’article 83 in fine de la loi sur l’organisation et le fonctionnement de la Cour constitutionnelle, attribue compétence à la Cour constitutionnelle de poursuivre l’ancien Président de la République ou l’ancien Premier ministre pour fausse ou absente déclaration de patrimoine familial, ou soupçon d’enrichissement illicite, dans les trente jours suivant la fin de leurs fonctions. Par conséquent, on peut aisément constater que la Cour constitutionnelle est l’unique juge compétent du Premier ministre, qu’il soit en fonction ou à la cessation des fonctions. Là où le constituant a voulu le contraire, il l’a clairement dit : dans ce cas précis, l’article 167 de la Constitution prévoit que « pour les infractions commises en dehors de l’exercice de ses fonctions, les poursuites contre le Président de la République et le Premier ministre sont suspendues jusqu’à l’expiration de leurs mandats. (…) La juridiction compétente est celle de droit commun ».
Ce chemin de la méthode systémique nous évite le risque de lire la Constitution, particulièrement l’article 164 comme une disposition législative du code pénal. La Constitution n’est pas un saucisson[6]. Il est grave de la découper en rondelles, comme un saucisson, en ignorant qu’un aucun article n’est isolable de l’ensemble du texte[7]. Une Constitution se réfère toujours, explicitement ou implicitement, à un certain type de régime politique, dont les principes éclairent l’interprétation de chaque disposition particulière. Voilà pourquoi, les interprètes de la Constitution utilisent, parfois, dans leur opération d’application de la Constitution, des fondements autres que le texte constitutionnel proprement dit[8]. C’est ce que le professeur Guastini appelle les « principes implicites »[9], c’est-à-dire des énoncés qui ne figurent pas expressément dans le texte constitutionnel. Par cette technique des principes implicites, « l’interprète introduit un nouveau champ terminologique (…) au terme d’un raisonnement déductif, inductif ou fondé sur la ratio legs d’une ou plusieurs dispositions textuelles »[10].
Il ne s’agit pas, en l’espèce, pour la Cour constitutionnelle agissant comme juge pénal, de créer de nouvelles incriminations, encore moins des peines (ce qui du reste n’est pas de la compétence du juge), mais de la détermination de la juridiction compétente. Ces règles pénales de forme procèdent certes du principe de la légalité[11], mais n’obéissent pas exactement aux mêmes modes d’interprétation que les règles pénales de fond. Elles peuvent « être étendues hors de leurs termes étroits et précis lorsque la raison, le bon sens et surtout l’intérêt supérieur de la justice pour lequel elles ont été édictées, commandent cette extension ; en cas de doute, les juridictions sont tenues de les entendre dans le sens le plus favorable à la personne poursuivie, celui où elles garantissent le mieux ses droits »[12]. La question demeure alors de savoir pourquoi la Cour n’a-t-elle pas garanti au prévenu l’avantage du privilège de juridiction afin d’assurer une bonne administration de la justice par des augustes juges, ainsi conforter son rôle central dans l’édification de l’État de droit.
Partant, l’idée n’est pas de faire de la Cour constitutionnelle un archéologue qui poursuit des fouilles pour trouver la pensée du constituant, mais plutôt le sculpteur qui, avec les matériaux du texte, sculpte la solution que lui suggère – notamment- l’équité ou l’idée qu’il s’en fait[13]. Kelsen ne dit-il pas que « la question de savoir laquelle des possibilités données dans le cadre du droit à appliquer est ‘exacte’ n’est pas une question de connaissance portant sur le droit positif, il ne s’agit pas d’un problème de théorie du droit mais un problème de politique juridique »[14]. Il est en effet dangereux d’attendre du constituant de surcharger les textes constitutionnels ou pénaux de détails et autres adverbes ou renvois – autant de fausses précisions – dont l’effet est d’obscurcir le sens de la règle juridique[15]. Le constituant a montré son hostilité à l’impunité des gouvernants en aménageant un régime de responsabilité pénale pour tous les gouvernants, la Cour constitutionnelle ferait œuvre utile d’orienter son activité en respectant cette sainte volonté. Un « simple » arrêt de la Cour constitutionnelle peut suffire à mettre en péril la réalisation de l’Etat de droit, tout en accroissant le risque d’impunité. Sa position sur le privilège de juridiction, pour justifier son incompétence, mérite ainsi d’être analysée en second lieu, car elle ouvre la voie à une situation de non-droit.
II. La lecture étroite du privilège de juridiction
Pour décliner sa compétence, la Cour constitutionnelle a affirmé que « le premier ministre pendant la durée de ses fonctions bénéficie d’un privilège de juridiction pour tous ses actes. Ce privilège de juridiction prend fin cependant avec les fonctions de premier ministre, lequel redevient à la fin de son mandat justiciable des tribunaux ordinaires ». Elle poursuit dans le même sens que : « La compétence juridictionnelle étant d’attribution, le prévenu MATATA PONYO MAPON Augustin, qui a cessé d’être Premier ministre en fonction au moment où les poursuites contre lui sont engagées, doit être poursuivi devant son juge naturel, de sorte que, autrement, il serait soustrait du juge que la Constitution et les lois lui assignent, et ce en violation de l’article 19 alinéa 1 de la Constitution ».
En effet, le privilège de juridiction peut être défini comme le droit reconnu à certains individus d’être jugé par une juridiction à laquelle les règles juridiques attribuent à titre dérogatoire compétence. Il constitue une exception au principe de l’égalité de tous devant la loi. Relativement au juge naturel, il peut être entendu comme le juge que la loi en vigueur désigne afin de connaître d’un différend ou litige précis en fonction de la qualité de la personne qui est poursuivie, mais également de la matière qui est concernée[16]. Pour l’affaire en cause, la Cour a considéré, sans le dire expresses verbis, que le juge naturel de Monsieur Matata est le juge de l’ordre judiciaire, puisque, selon elle, le privilège de juridiction a pris fin avec les fonctions de Premier ministre.
Cette extension de la compétence des juridictions judiciaires aux actes relatifs à l’exercice des fonctions du Premier ministre ne peut qu’inquiéter tout esprit juridique. En effet, dans le treizième feuillet de l’arrêt, la Cour a soutenu à bon droit que le privilège de juridiction reconnu au Président de la République et au Premier ministre se justifie par le fait que » il s’agit d’une question présentant un caractère politique trop accentué pour être examiné par une juridiction de l’ordre judiciaire ». On ne peut comprendre comment la Cour a-t-elle pu en même temps reconnaitre le « caractère politique trop accentué des infractions commises par le Président ou le Premier ministre dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions », pour justifier l’incompétence des juridictions de l’ordre judiciaire à connaitre de telles infractions, et en même temps renvoyer, pour cette affaire entrant largement dans le même champ, la compétence à une juridiction de l’ordre judiciaire.
De plus, la Cour a soutenu à tort que « pour tous les actes du Premier ministre, y compris ceux accomplis en dehors de ses fonctions, il bénéficie d’un privilège de juridiction le mettant largement à l’abri puisque les particuliers ne peuvent saisir la Cour constitutionnelle ». Comme on l’a évoqué plus haut, l’article 167 de la Constitution dispose que les poursuites contre le président de la république et le premier ministre pour les infractions en dehors de l’exercice de leurs fonctions relèvent de la compétence de la juridiction de droit commun, écartant ainsi tout privilège de juridiction. Il en découle que le privilège de juridiction ne concerne que les actes accomplis dans l’exercice des fonctions. Néanmoins, de la position de la Cour sur le privilège de juridiction découle une interrogation : comment le constituant, au regard de la finalité du privilège de juridiction de mettre à l’abri, pourrait-il en même temps mettre à l’épreuve un ancien Premier ministre face à des possibles actions vindicatives devant les tribunaux ordinaires pour les actes accomplis dans sa fonction ? Le privilège de juridiction n’est-il pas plus important après la cessation de la fonction, pour au moins protéger le prestige de la fonction ?
D’autre part, la responsabilité qui est engagée en l’espèce devant la Cour constitutionnelle, est celle des actes de la fonction de Premier ministre, c’est-à-dire un prétendu mauvais usage des pouvoirs ou fonctions prévus par la loi, en l’occurence le détournement des deniers publics. Il faudrait noter qu’un Premier ministre peut trahir la nation ou l’État toutes les fois qu’il exerce, au détriment de l’État, son autorité légale[17]. Ces actes posés dans l’exercice des fonctions relèvent du ressort d’une responsabilité particulière pour lesquels (ces actes) la personne poursuivie doit être distinguée du reste des citoyens. Il en résulte que la nature de cet accompli dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice des fonctions de Premier ministre ne peut, comme le veut le constituant de 2006, relever de la compétence des juridictions ordinaires, même pas après la cessation de la fonction. Pour tous les actes hors fonctions, la personne poursuivie ne sera pas responsable comme membre du gouvernement, mais soumise à la justice ordinaire, comme tout autre individu. On constate dès lors que cette différence de nature d’actes et de responsabilité entraine une distinction de juge compétent.
Par ailleurs, il n’est pas anodin que la Cour constitutionnelle ait pris soin, pour se déclarer incompétente, de ne pas se baser sur l’article 164 de la Constitution. Car le constituant, dans l’intelligibilité de sa rédaction, a précisé à l’article 164 que la Cour constitutionnelle est le juge pénal du Président de la République et du Premier ministre pour les infractions politiques (…) et pour les autres infractions de droit commun commises dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions. Cette disposition constitutionnelle signifie que le privilège de juridiction s’applique non pas seulement aux actes accomplis présentement dans l’exercice des fonctions, mais il s’étend aussi aux actes de fonction commis au moment où la personne occupait la fonction de Président de la République ou de Premier ministre. Cette lecture rencontre le principe de la cristallisation en droit pénal qui veut que le moment de la commission des faits détermine également le juge compétent. C’est également l’interprétation qu’avait faite la Cour suprême de justice en statuant, dans son arrêt du 28 août 1981, que « la Cour d’appel, en vertu de l’article 98 du code de l’organisation et de la compétence judiciaires, est compétente pour juger un ancien magistrat si les faits reprochés à ce dernier ont été commis dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de sa fonction, pendant qu’il était encore magistrat et en relation avec son ancienne fonction »[18]. On peut dès lors se demander, au regard de sa poursuite de l’idéal de l’État de droit, pourquoi la Cour constitutionnelle n’a pas voulu suivre la position de la Cour suprême de justice.
L’analyse du droit comparé renforce de surcroît cette interrogation. En droit français, l’article 68-1 de la Constitution française dispose que « les membres du Gouvernement sont pénalement responsables des actes accomplis dans l’exercice de leurs fonctions et qualifiés crimes ou délits au moment où ils ont été commis. Ils sont jugés par la Cour de justice de la République ». Cette disposition constitutionnelle a été interprétée aussi bien par la Cour de justice de la République que par la doctrine[19] comme attribuant compétence à la Cour de justice de poursuivre les membres du gouvernements anciens ou actuels pour les actes accomplis pendant l’exercice de leurs fonctions. C’est dans ce cadre que d’Edouard Balladur et de François Léotard, respectivement premier ministre et ministre de la défense entre 1993 et 1995, ont été jugés devant cette Cour dans l’affaire de système de financement politique occulte. Charles Pasqua, après avoir quitté ses fonctions de ministre de l’intérieur en 1995, a été jugé en 2010 par la Cour de justice de la république pour des actes accomplis dans l’exercice de ses fonctions de ministre de l’intérieur. Pourtant le constituant français n’a même pas précisé dans le texte constitutionnel l’expression « actes accomplis à l’occasion de leurs fonctions » (supposition envisagée dans le texte constitutionnel congolais).
La Cour constitutionnelle en se déclarant incompétente a donc baissé pavillon. En l’espèce, M Matata n’a pas été poursuivi pour les actes accomplis en dehors des fonctions, mais plutôt pour les actes relevant de la qualité de Premier ministre. Dans ce cadre, il continue de bénéficier du privilège de juridiction. En revanche, s’il était poursuivi pour des infractions telles que l’homicide commise durant sa fonction, il n’aurait pas péché comme Premier ministre, il serait violateur des lois communes et justiciable des tribunaux ordinaires. La question de l’impossibilité de sa déchéance nécessite également un éclairage utile.
III. Le moyen de la déchéance développé par les conseils du prévenu Matata
Le prévenu Matata, par ses conseils, a soulevé deux exceptions tirées respectivement de l’incompétence de la Cour et de l’irrecevabilité de l’action du Ministère Public. Parmi ces moyens, il soutient que l’article 167 alinéa 1er de la Constitution a prévu que « en cas de condamnation, le Président de la République et le Premier ministre sont déchus de leur charge, déchéance prononcée par la Cour constitutionnelle, mais que lui n’étant plus en fonction il ne saurait en aucun cas et en aucun moment être déchu ». De ce qui précède, il sollicite de la Cour de dire qu’elle est incompétente.
En effet, considérer l’impossibilité de la déchéance du prévenu Matata comme l’une des causes de l’incompétence de la Cour constitutionnelle est une aberration à plusieurs titres. Cette lecture signifierait que la responsabilité pénale est placée sous le joug de la responsabilité politique en dépit de leur hétérogénéité. Pourtant, historiquement, c’est la responsabilité politique des gouvernants qui s’est progressivement substituée à une responsabilité de type pénal[20]. Cette conception de subordination de la compétence pénale de la cour constitutionnelle à la sanction de déchéance est ensuite réductrice, car elle ignore l’autonomie dont jouit la responsabilité pénale vis-à-vis de la responsabilité politique[21]. Cette autonomie se fonde sur le principe de la séparation des pouvoirs et le principe d’égalité de tous les citoyens devant la loi, ce qui signifie que les gouvernants, comme tous les citoyens, doivent répondre des actes qu’ils accomplissent. Elle (l’autonomie de la responsabilité pénale) a été rappelée, en France, par la Cour de justice de la République dans son arrêt du 9 mars 1999 relatif au procès du sang contaminé. Celle-ci précisa dans un attendu de principe « que la responsabilité politique – à en supposer la notion, les critères, et la mise en œuvre précisément définis, ce qui n’est pas de la compétence de la Cour, – n’est exclusive ni de la responsabilité civile et administrative de l’État, ni de la responsabilité pénale ; Qu’en effet, les dispositions de l’article 68-1 de la Constitution, applicables en l’espèce, consacrent expressément l’autonomie de la responsabilité pénale des membres du gouvernement en cas de crimes ou délits commis dans l’exercice de leurs fonctions, sans faire de distinction entre les infractions intentionnelles et les infractions non intentionnelles ». L’absence de responsabilité politique (des sanctions politiques) ne fait pas donc pas obstacle à la mise en mouvement de la responsabilité pénale, on veut dire de l’action publique.
Il en découle aussi que la cessation des fonctions de Premier ministre n’exclut pas la compétence de la Cour constitutionnelle, car la déchéance, entendue comme la perte d’un droit à titre de sanction, prévue à l’article 167 de la Constitution n’est que la conséquence de la condamnation pénale. Elle constitue une peine complémentaire n’existant que dans l’hypothèse où il y a la peine principale de condamnation. C’est pourquoi que le constituant a pris le soin de préciser « en cas de condamnation ». Sans déchéance, la sanction pénale demeure présente.
En guise de dénouement, on peut dire que l’incompétence déclarée dans cette affaire par la Cour constitutionnelle, sous couvert de respect de la légalité, est en réalité un déni de justice. Il y a longtemps que l’analyse juridique contemporaine n’adhère plus au récit suivant lequel le juge se limiterait seulement à « d’appliquer le droit » comme une bouche qui prononce les paroles de la loi[22]. En appliquant la loi, en expliquant la portée exacte d’une disposition, le juge fait de l’interprétation, et à ce titre il n’arrête pas de créer le droit[23]. Cela est d’autant plus vrai pour la Cour constitutionnelle qui opère dans un environnement où non seulement l’interprétation est décentralisée entre les divers pouvoirs publics[24], mais aussi où la réalité politique a montré ce qu’une écriture constitutionnelle a de plus incomplet. Et là où il y a pouvoir d’appréciation, il peut et il doit même y avoir une politique de l’institution qui fait usage de ce pouvoir[25]. La Cour constitutionnelle doit faire habituer les pouvoirs publics et l’opinion à la légitimité et l’opportunité de son existence, encore que le sentiment commun de l’opinion publique est que règnent l’impunité dans la classe politique et la désacralisation des fonctions publiques. Cet arrêt n’a fait que renforcer ce sentiment, faisant au passage l’avortement de l’effectivité du droit constitutionnel pénal.